Un texte écrit lors de l’atelier des Mots parleurs du 7 décembre 2017 “délocalisé” aux Gratte-Ciel
La Vie des autres
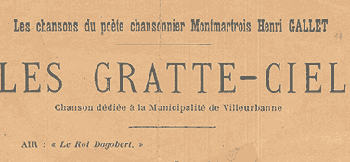
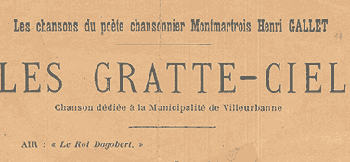
Un texte écrit lors de l’atelier des Mots parleurs du 7 décembre 2017 “délocalisé” aux Gratte-Ciel
Joséphine
A côté du rond-point, il y a une grande place. Sur cette place, un marché. Un marché de producteurs. Tous les samedis matin. Tous les samedis matin, sur cette grande place, à côté du rond-point, je croise Joséphine. Joséphine, elle est toute menue et traîne derrière elle un chariot qu’elle remplit de légumes de saison, de fruits mûrs à point, de plantes aromatiques. Joséphine, elle a les cheveux jaunes comme le soleil de cet hiver. Elle arrive très tôt le matin, certains maraîchers n’ont pas encore fini de déballer. Jamais elle ne s’impatiente, jamais ne passe devant personne ni ne discute un prix. Hier matin, je n’ai pas croisé Joséphine. Quelqu’un l’a vu faire plusieurs fois le tour du rond-point, puis disparaître sous les roues d’une voiture.
Pépé
Sur cette place, il y a Pépé. Pépé le Moko comme on l’appelle. Vous l’avez certainement rencontré : casquette en coton gris clair sur la tête, gitane dans un coin de la bouche, là où il lui manque une dent. Pépé, il aime passer des heures sur cette place, la place juste à côté du rond-point, là où il y a le marché le samedi matin. Pépé, il a son banc à lui, et n’aime pas en changer. Le sien, c’est celui qui tourne le dos au bureau de tabac. L’autre jour, alors qu’il commençait juste à traverser la place, il vit quelqu’un assis sur son banc. Il n’en crut pas ses yeux. Non d’une pipe ! Qui cela pouvait-il bien être à une heure aussi matinale ! Il s’avança comme un matou, mordant sur sa gitane et grommelant entre ses dents jaunies. Pépé avait la vue qui avait bien baissé ces derniers temps. À deux mètres seulement du banc, il la reconnut : Joséphine !
– Alors, t’es pas morte ? lui lança-t-il en guise de bonjour.
Chantal Roy, le 22 octobre 2015
Document d’archives : Giratoire de Patrick Raynaud, place Louise Michel (1989)

Je revois … à l’angle de la rue Flachet et du cours Emile Zola… une impasse où s’entassaient quelques maisons dont l’aspect très rudimentaire laissait transparaître pauvreté et précarité.
Nous étions en 1956 ou 1957 environ, années où sévissait une crise du logement très dure pour de nombreux citoyens, en particulier pour le monde ouvrier.
L’on ne pénétrait pas dans ses maisons, qui étaient souvent l’objet de mépris et d’indifférence de la part des habitants du quartier. L’accès nous en était interdit, mais l’on pouvait apercevoir, depuis le cours Emile Zola, des baraquements – en bois ou en béton ? la mémoire m’échappe- de petite taille, dont la porte d’entrée s’ouvrait sur l’impasse en terre battue.
L’une de mes camarades de classe habitait là, et nous décrivait son habitat de manière précise, sans aucune gêne. Le plus éprouvant pour moi était de l’entendre me parler de l’intérieur de sa maison, en particulier du sol en terre battue. Nous aussi étions mal logés, mais du moins, nous vivions sur un sol carrelé. Ces habitations comportaient une ou deux pièces seulement qui logeaient toute une famille, parfois nombreuse. Quatre, cinq, six, voire sept ou huit personnes s’entassaient dans quinze ou vingt mètres carrés. Le soir, ils déballaient les matelas pour dormir, et dans la journée, ils les empilaient dans un coin de la pièce commune.
En tournant au coin de la rue, et en prenant la rue Flachet, on découvrait de multiples commerces : boucher, bar tabac-journaux, épicerie, charcuterie, , et juste en face de notre logement, une modiste vendait des chapeaux de toutes sortes. Ma mère, qui adorait les chapeaux, y faisaient de fréquentes visites, et j’étais toujours émerveillée par la diversité des modèles, des tissus, des formes, des couleurs … En remontant la rue, après notre logement, nous pouvions encore découvrir une laverie et une triperie, une laiterie à l’enseigne du « Bon Lait », une droguerie-quincaillerie, véritable caverne d’Ali Baba, un magasin de vêtements et de lingerie, où les dessous féminins en soie et dentelle côtoyaient layette et vêtements pour enfants, un magasin de chaussures, et plus loin encore … une épicerie, un marchand de journaux – comme on le nommait à l’époque-puis tout au bout de la rue, un café-jeu de boules…
Nous habitions au 36 de cette rue. Ce numéro était protégé par un grand rideau en fer gris, la plupart du temps fermé, et, tout à côté, une petite porte de même fabrication et de même couleur. En ouvrant cette porte, l‘on découvrait tout d’abord une rangée de boîtes aux lettres, puis une autre porte, en bois, qui donnait accès à l’appartement des tenanciers de la laverie ; et lorsqu’on avançait encore, se dressait, majestueux, l’immense escalier qui menait aux appartements de nos propriétaires. Cet escalier, qui me semblait fait de marbre, toujours impeccablement reluisant, nous était interdit d’accès, bien évidemment.
Notre appartement était situé au fond d’une cour, une cour qui n’était sans doute pas très grande, mais qui, dans mon souvenir, reste immense. Fermée d’un côté par un mur garni de tessons de bouteilles, elle renfermait des mondes et des trésors sans cesse à découvrir. Un atelier de fabrication de balances était installé du côté opposé à ce mur, fermé par une porte en bois ; la lumière y pénétrait par de grands vitrages. Lorsque la porte était fermée, je me hissais sur la pointe des pieds pour observer les ouvriers qui travaillaient dans l’atelier, mais lorsqu’elle était ouverte, j’osais entrer et découvrais le monde à chaque fois. Des machines étaient installées sur de grandes tables en bois ; sur des planches étaient posés des outils, vis, clous … Quelquefois, des ouvriers maniaient le fer à souder ; j’aimais particulièrement les couleurs des petites étincelles qui jaillissaient au contact de la matière, et aussi, l’odeur, une odeur de soufre. J’aimais aussi l’odeur des poutres, entreposées un peu partout dans la cour, et celle de la ferraille, omniprésente dans cet univers.
Une autre porte, à côté de l’atelier, restait la plupart du temps fermée ; et pour moi, petite fille, l’accès en restait mystérieux. Quelquefois, elle restait exceptionnellement ouverte, mais là encore nous n’avions pas la permission de la franchir. « Trop dangereux « nous disaient les parents. Un jour, cependant, nous avons eu l’immense joie d’accéder à cet univers interdit : d’un côté, l’atelier se déployait sur toute sa longueur, et de l’autre, nous découvrions l’arrière- boutique de la droguerie où s’empilaient pots de peinture, et objets divers. Je n’ai jamais compris en quoi ce lieu pouvait être dangereux.
Mais revenons de l’autre côté de la cour … un autre mur donnait sur l’arrière- boutique de la laverie et de la triperie. L’arrière- boutique de la laverie disposait d’une large fenêtre d’où nous pouvions apercevoir la commerçante qui repassait le linge de ses clients, et juste à côté, dans un recoin, les tripiers déposaient leurs immenses baquets d’abats aux odeurs âcres et fumantes.
Nous disposions d’un seul WC, « à la turque », dont la porte se fermait à l’aide d’une clé ; il était accessible à tous ceux qui circulaient dans cette cour – à l’exception des propriétaires, qui bien entendu, disposaient de toilettes dans leur appartement. Pour satisfaire un besoin pressant, il fallait courir et traverser la cour dans toute sa longueur ; certains jours, les tripiers y déversaient leurs grands baquets, ce qui dégageait une odeur fort désagréable.
Notre appartement était situé en face de ces arrière boutiques, juste à côté de l’atelier. Nous vivions à six dans un « deux pièces cuisine » qui ne devait pas occuper une superficie supérieure à trente mètres carrés. Mais nous avions l’eau courante et l’électricité . Pour nous chauffer, nous descendions « à la cave », munis d’un seau à charbon, et remontions chargés de ces précieuses boules noires qui nous apportaient leur chaleur. Nous n’avions pas de salle de bains, juste un unique évier qui servait à tout – vaisselle, lessive, toilette – pas de machine à laver, pas de télévision, mais une radio qui diffusait régulièrement ses feuilletons, jeux et autres émissions.
Mais nous avions ce que j’affectionnais par- dessus tout, et qui, pour moi, valait toutes les télévisions et autres appareils modernes : une bibliothèque. Mon père en avait fabriqué deux, de ses propres mains : l’une était pour lui, installée dans un recoin de la cuisine. Nous n’y avions pas accès, et nous l’entendions souvent nous dire « c’est ma bibliothèque » de la même manière qu’il aurait dit « c’est mon trésor à moi ». L’autre était posée sur un meuble, dans la pièce commune où nous dormions tous ; nous la partagions, ma sœur et moi, et régulièrement, nous lisions, rangions, classions et relisions ce que nous considérions nous aussi comme des trésors.
Mon père était ouvrier, nous n’avions pas beaucoup d’argent, mais nous avions des livres.
Nous étions petitement logés, mais ma mère tenait à ce que notre intérieur soit propre, aussi
mettait-elle beaucoup d’énergie à laver, frotter, astiquer sols et meubles. Elle prenait plaisir à fleurir l’entrée de l’appartement, avec des géraniums qu’elle repotait à chaque printemps et qu’elle installait sur le rebord de la fenêtre. J’aimais l’odeur de ces plantes, ainsi que celle de l’eau sur les volets quand elle décidait de les laver.
J’aimais jouer dans la cour, avec mes frères et sœurs. La présence de murs, et les nombreux recoins, nous permettaient d’expérimenter de multiples jeux « Un, deux, trois .. soleil », « Colin maillard », jeux de balles, de ballons, marelle, …
Nous étions petitement logés, nous ne pouvions accueillir personne dans notre modeste « deux pièces cuisine ». Nous ne pouvions recevoir nos copines, ni les inviter à goûter, ni les garder pour dormir comme le faisaient d’autres familles.
Mais le monde venait à nous par la cour, lieu à la fois ouvert et fermé, accessible et interdit, où se mêlaient odeurs, bruits, et conversations.
Un monde fait d’amour, d’émotions, et de surprises.
Marie-Noëlle George
Document d’archives : Habitat précaire à Villeurbanne en début des années 1930